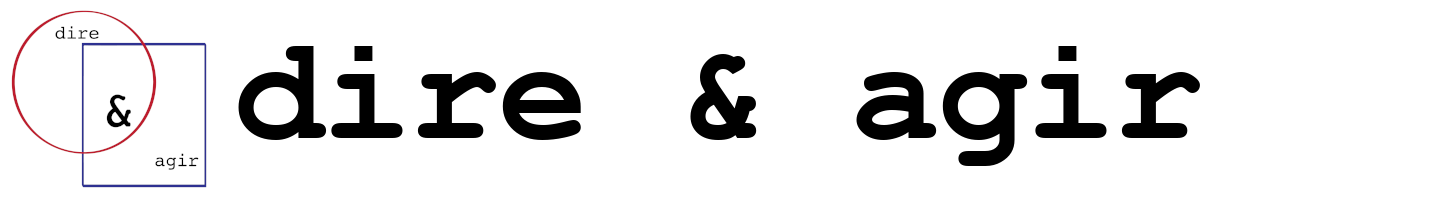Rapport concernant le voyage d’Alain Schwaar et Sylvie Uhlig Schwaar en Angola, du 16 au 29 juillet 2014
Séminaires à Uige du 18 au 25 juillet 2014
Mandat de la paroisse de Saint-Imier
Ce qui nous avait été demandé, c’était notamment d’aborder la question de l’élaboration et la gestion de projet, dans la paroisse d’Uige. La paroisse de St Imier avait fait la demande en ce sens et s’était engagée à payer notre déplacement à Uige, ce dont nous la remercions vivement !
Introduction
Notre approche
Nous avons développé, particulièrement dans des pays ayant un passé de traumatismes multiples, comme Haïti (depuis plusieurs années) et l’Angola (cette fois), une méthode d’intervention auprès de groupes, avec des populations de milieu rural principalement.
Cette démarche a pour objectif de questionner, d’accompagner les gens par l’expérimentation d’un dialogue démocratique qui permet d’envisager des actions à partir des ressources et des potentiels présents dans le groupe.
Méthode de travail
Notre domaine d’action se situe dans le cadre du travail avec des groupes dont la diversité est un facteur important (personnes « de la base », leaders, intellectuels, femmes et hommes …) dont le nombre peut varier entre 10 et 30 personnes.
La méthodologie de type participative, inspirée principalement par la thérapie sociale, l’approche narrative et la prise en compte des traumas, nous permet d’offrir un cadre permettant par exemple l’élaboration de micro-projets personnels et collectifs apportés par les personnes elles-mêmes, avec un souci et un travail particuliers (de notre part) concernant les conditions préalables qui vont influencer la bonne marche de la démarche.
Premier pas : apprendre à se connaître mutuellement
Il y a en effet chaque fois un travail d’approche nécessaire et préliminaire, qui doit se faire entre les intervenants et les participant-e-s pour permettre l’instauration progressive d’un sentiment de confiance et de sécurité au sein du groupe : tant pour les participant-e-s qui s’attendent souvent à une sorte de cours formel de notre part, tant pour nous qui devons être « introduits » peu à peu dans le contexte et le mode de vie des gens.
Les obstacles
Les obstacles à faire un travail de groupe ensemble, qui affectent aussi bien les personnes que les relations dans le groupe doivent à tout moment être évoqués, interrogés et travaillés pour que ce type de travail ait du sens.
En effet, il existe de nombreuses peurs et violences – en partie cachées – qui peuvent faire partie des effets des traumatismes récurrents subis par la population (p.ex. catastrophes naturelles, passé de colonialisme et de guerre, pauvreté etc.) et qui vont s’exprimer de la même manière dans le fonctionnement du groupe que dans la société (associations, institutions, église etc.. ). En Angola, p.ex. le principal problème de société cité par les femmes que nous avons vues est la violence domestique !
Notre à-priori de base est de considérer ces peurs et ces violences non comme faisant juste partie de pathologies individuelles, mais bien comme des freins au « vivre ensemble » et à un travail en commun, et que nous pouvons donc les traiter au sein de ce groupe qu’on constitue ensemble.
Organisation du séjour
Le programme avait été élaboré par mail avec la IERA, à savoir le chargé de communication (Pedro Quinanga), le secrétaire général et le responsable du synode d’Uige (Silva Matemba). M. Matemba étant emprisonné (depuis mai et pour une question liée à un accident de voiture datant de 2011), il a été remplacé par le pasteur Paulo Pumba.
Le retard d’un avion à Genève a eu pour conséquence de retarder notre arrivé à Luanda d’un jour, et par conséquent aussi à Uige.
Cela a permis de rediscuter du programme et de nos souhaits avec le pasteur Pumba, et avec Dona Anotas, responsable des groupes de femmes de la paroisse.
Séminaires
Il a été jugé utile de remettre au lundi 21 juillet le début des séminaires. Deux groupes ont été constitués, en raison de l’organisation de la vie à Uige. En effet, plusieurs participant-e-s avaient un emploi et travaillaient soit le matin, soit l’après-midi, dont plusieurs professeurs. Il a fallu en tenir compte et mener deux groupes parallèlement : un groupe du matin et un autre groupe de l’après-midi pendant 3 jours, entrecoupés par la journée des femmes. Une bonne mise à l’épreuve pour nous, qui prônons le réalisme et l’adaptabilité !
De plus, le lieu des cours étant éloigné de la ville de Uige, les déplacements n’étaient pas simples pour les participants, à tel point que certains n’ont pu venir que le deuxième jour par exemple, ou alors en retard. L’obligation de présence, une des règles de la démarche de thérapie sociale pour assurer un cadre de sécurité, a été plutôt mise à mal, en l’occurrence !
Malgré tout, les séminaires ont eu lieu !
Groupe du matin
Le groupe du matin a démarré avec 14 personnes aux profils très divers (professeurs, sage-femme traditionnelle, paysannes etc.) : plus de femmes que d’hommes, et des hommes déjà très formés. Il y a eu des exercices pour faire connaissance, dépasser les préjugés et les peurs, pour mieux travailler ensemble. Les hommes n’ont cependant pas mâché leurs mots à la fin de cette première journée pour dire leur déception de ne pas avoir reçu « du matériel ».
Le lendemain, nous avons abordé la question des projets en commençant par un petit apport théorique sur les objectifs, en utilisant de grandes feuilles de papier au mur (seul média que nous utilisons). Les participants ont commencé à s’impliquer plus personnellement, en parlant de leurs projets. Et ils en avaient ! Dont certain-e-s parlaient pour la première fois, dirent-ils.
Le 3ème jour a été dédié à un travail plus en profondeur, plus précisément sur un projet présenté par un participant : celui de l’assainissement de base (saneamento bàsico) qui concerne l’hygiène publique, la gestion des déchets etc…), et sur le travail de sensibilisation à faire auprès de la population sur ce thème. Trois sous-groupes se sont constitués pour aborder la sensibilisation dans trois lieux différents d’Uige: école, marché, église.
Les sous-groupes ont été formés en mettant ensemble des personnes de la base (dames qui vendent au marché p. ex) et des intellectuels (professeurs…). Ces personnes ont parlé ensemble (ce qui leur aurait paru fort improbable dans d’autres circonstances) et ont pu ainsi s’enrichir mutuellement.
Une des choses qui nous ont marqués : souvent les gens disent « on en a parlé pour la première fois « . Cela signifie pour nous, une fois de plus, que l’étape : faire connaissance, parler en petits groupes de soi, de ses peurs etc., décriée d’abord par les intellectuels, est vraiment nécessaire. C’est un préalable pour parler ensemble des besoins, des envies, des projets, pour en arriver à pouvoir envisager de travailler ensemble.
Groupe de l’après-midi
Au groupe de l’après-midi sont venues 7 personnes : des femmes et un seul homme. Ce séminaire était axé sur « mieux vivre et travailler ensemble « . Il y avait plusieurs veuves et femmes seules dans ce groupe, et l’homme était intéressé par un espace pour des préoccupations d’ordre social dans l’église. Les discussions préliminaires ont débouché sur un exercice « comment écouter quelqu’un pour l’aider à exprimer un problème ? », puis les critères d’une écoute active (escuta activa) ont été développés comme étant un moyen simple d’aider les gens de la communauté à extérioriser leurs difficultés et parties de leurs traumatismes.
Et le 2ème jour, nous avons pu vivre quelque chose d’extraordinaire : un groupe de femmes, manifestement de la campagne, est arrivé… avec une heure de retard. Que faire ? On a choisi de demander à une participante de résumer ce qui avait été fait le jour précédent. Elle a commencé en portugais, puis a fini en kikongo. Ça a été tellement bien fait, qu’elles ont ensuite refait l’expérience de l’écoute active avec les nouvelles arrivées (dont une vieille dame) qui racontent un événement difficile et des anciennes (déjà un peu rodées) qui écoutent et qui observent. Grand moment, quasi miraculeux : là encore on en arrive au même phénomène qu’en Haïti par exemple, les gens parlent, racontent, sont écoutés…. et disent qu’ils se sentent soulagés, allégés.
De manière générale, quand elles évoquent leurs problèmes spécifiques, les femmes disent qu’outre les violences domestiques, elles souffrent beaucoup de discrimination notamment du fait que leurs activités – aussi dans le cadre de l’église – sont moins valorisées ou prises en compte que celles des hommes et qu’elles, les femmes, sont moins écoutées et prises au sérieux.
Dernier jour : « psycho-éducation » sur les traumatismes
La dernière matinée, consacrée aux traumatismes, a été proposée aux gens des deux groupes.
La démarche est là un peu différente des autres ateliers-séminaires. Elle se base sur l’idée que le fait de donner un certain nombre d’informations concernant la nature et les effets prévisibles des traumatismes sur l’individu et la collectivité, peut permettre aux gens d’identifier et de comprendre certains comportements (chez eux ou chez les autres) qui peuvent être accueillis comme tels, et dès lors améliorés à travers ce nouvel éclairage.
Souvent, et cela a été le cas aussi lors de cette présentation, les personnes se sentent déjà un peu soulagées (selon leurs propres termes) en constatant que les effets des traumatismes existent, qu’on peut les nommer et surtout que les personnes qui en sont affectées ne sont pas « folles ».
Un changement d’attitude peut donc s’ensuivre (déjà en écoutant activement la/les personne-s affectée-s p. ex.) et surtout, les gens peuvent se reconnaître comme ayant été victimes d’une situation de vie « anormale » ou « hors-normes »(comme, en Angola, de la guerre civile qui a duré plus de 30 ans) et oser, peu à peu, parler de certaines choses ensemble, sortir de la méfiance et reprendre confiance en eux-mêmes, dans les autres, dans l’avenir…
Des éléments de soin et de résilience existent déjà et peuvent être développés dans la collectivité : on ne peut s’empêcher de penser à ce propos, en Angola, à cette merveilleuse activité collective qu’est le chant en chœur, dont nous avons été baignés durant tout notre séjour avec bonheur.
Durant cette dernière matinée, encore, une participante à pu faire une présentation de l’écoute active absolument remarquable.
Cela pourrait donc être mis en oeuvre immédiatement ! Et c’est un type de projet qui ne coûterait rien (ça pourrait se faire dans un coin d’une église par exemple).
Evaluations
La journée s’est terminée par l’évaluation orale des participant-e-s, qui s’est révélée positive, et une évaluation globale écrite a été faite par le pasteur Pumba et transmise à la IERA (cf annexe).
Remerciements
Nous aimerions remercions particulièrement Philippe Nussbaum, Domingos Bongo, Pedro Quinanga, l’équipe de la IERA à Luanda, le pasteur Paulo Pumba, Dona Anotas, Mama Jorneza, Mama Regina et Mama Anita de Kikaya qui ont rendu possible, organisé, accompagné ce voyage, assuré le bon déroulement des séminaires, nous ont nourri et hébergé avec tant de gentillesse…
Nous remercions également Joël Pinto pour ses traductions de textes français-portugais qui nous été précieuses. Nous restons bien en pensée également avec le pasteur S. Matemba.
Août 2014, Alain Schwaar, Sylvie Uhlig Schwaar.